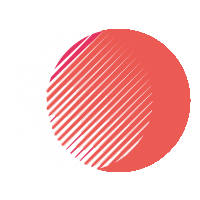Les Sculpteurs
Antoine-Joseph Salamon
Goritz 1810- Toulouse 29 mars 1850
La formation de Salamon n’est pas connue. La première mention du sculpteur se trouve dans un compte-rendu de l’exposition des beaux-arts de Toulouse en 1835. Il présenta un groupe, Adam et Eve qui fut vivement critiqué. Le buste d’Adam fut jugé incorrect, les cheveux d’Eve paraissaient tristes, son corps manquait de modelé. Par contre sa tête de jeune française suscitait un regard bienveillant et lui valut une médaille de bronze.
Le petit cloître des Augustins
Dès cette année, Salamon collabora avec Auguste Virebent sous la direction d’Alexandre Dumège à la restauration du petit cloître du Musée des Augustins. Les reliefs anciens qui ornaient les murs au-dessus des arcades, et les statues nichées ayant disparu, ils furent remplacés par des moulages de deux bas reliefs sculptés par Nicolas Bachelier pour l’hôtel du Vieux Raisin, et de quatre bas reliefs du tombeau de Biron. Quatre statues inspirées de La Mise au tombeau de Biron y trouvèrent place aux quatre angles.
L’artiste aurait pu douter de son travail après les commentaires essuyés en 1835. Ainsi que le souligna cruellement et outrancièrement le rapporteur de l’exposition, Louis Becane, le 17 juillet 1840, l’artiste gagnait sa vie en réalisant « des ornements en bois, des arabesques pour chaises et fauteuils », dans un petit atelier « d’une rue peu opulente ». Mais Becane eut aussi le plaisir de noter que l’artiste n’avait pas baissé les bras, et présentait à l’exposition de 1840 deux groupes dont il fit grand éloge : une Piéta, en frêne et un Génie funèbre, en plâtre.
La piéta

Pieta d’Auterive